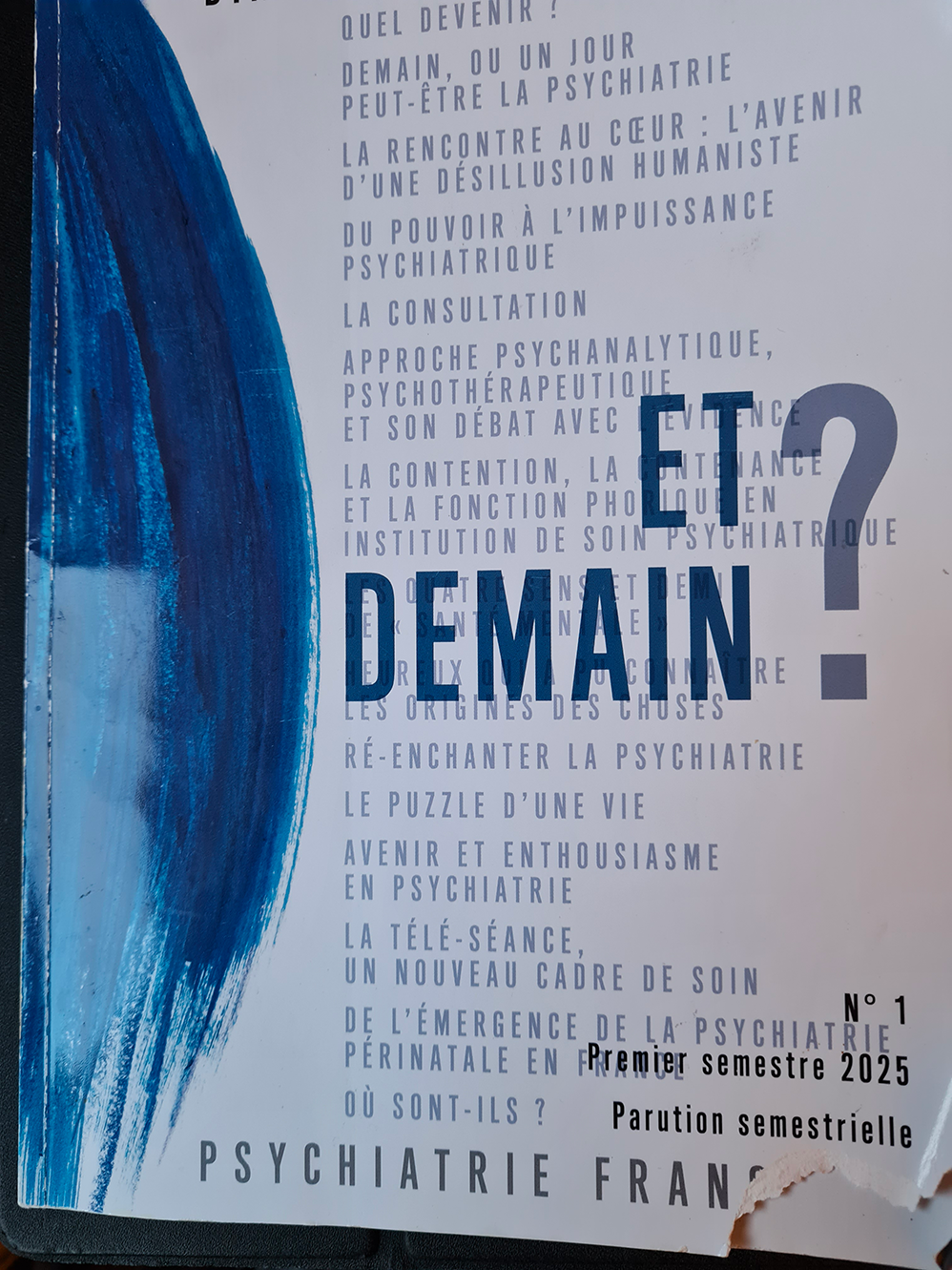Infiltration de l’idéologie « positive » dans la politique d’accueil de la petite enfance
22 septembre 2025UNE REPRÉSENTATION À FONCTIONS MULTIPLES
6 janvier 2026Les quatre sens et demi
Cet article a été initialement publié dans Dialogues et Controverses, n° 1 , premier semestre 2025, revue éditée sous l’égide de l’Association Française de Psychiatrie. Sa reprise dans l’édition numérique de la revue assure une complémentarité structurée entre publication imprimée et diffusion en ligne, offrant ainsi une synergie au service de la communauté psychiatrique.
1. Historiquement, à partir de 1948 (Congrès de Londres), le terme de « santé mentale » a remplacé celui d’« hygiène mentale."
L’hygiène mentale s’était compromise dans l’entre-deux-guerres avec les régimes autoritaires. Lors des congrès internationaux des années trente, les questions et les pratiques de stérilisation des malades mentaux ont été discutées (aux États-Unis, en Suède, en Allemagne, etc.) sans susciter beaucoup de protestations. Pendant la guerre,« l’hygiène raciale » a conduit à des pratiques d’euthanasie en Allemagne et en Autriche. Le terme de « santé mentale » apparaît dès les années 1920-30 pour désigner un vaste programme de santé publique appliqué à l’ensemble de la population. Il s’appuie sur des pratiques de dépistage des personnes fragiles, non encore malades mais risquant de le devenir, et sur des pratiques de sélection professionnelle pour certains emplois et d’orientation scolaire pour les enfants. Cette dimension de prise en charge de l’ensemble de la population a contribué à la conception de programmes de prévention primaire pour prévenir les maladies et de programmes de prévention secondaire pour favoriser les traitements précoces.
2. Depuis le XXème siècle une culture de la recherche individuelle de la "santé mentale comme équivalent de la santé physique est apparue
Il est probable que cette quête de la santé mentale soit un équivalent séculier de la quête du salut religieux. En effet, les directives de l’époque pour atteindre la santé mentale avaient un ton catéchétique et partageaient certaines valeurs avec les religions. Que penser, par exemple, de ce conseil de gymnastique mentale : « apprenez à ne penser à rien » ?
De plus, à la même époque, le développement de la psychanalyse modifie les normes de la morale sexuelle et remet en cause les normes traditionnelles, fragilisant la morale. Malgré cette complexité, dans les années 1960, l’OMS définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social ».
Dans les années 1970, le Québec propose le concept de « santé mentale positive ». La création d’instruments de mesure, avec des échelles d’évaluation et d’auto-évaluation, lui confère une aura de scientificité. Là encore, l’hypothèse d’une construction culturelle alternative aux valeurs religieuses semble pertinente dans les pays qui « sortent de la religion». Par la suite, l’OMS définira en 1977 la santé mentale comme « un état de bien- être qui permet aux individus de développer pleinement leur potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et de contribuer à la vie de leur communauté ».
3. Dans les années 1950, après la Seconde guerre mondiale des critiques techniques et politiques ont été formulées à l'encontre de la psychiatrie
Les hôpitaux psychiatriques et la psychiatrie ont suscité la peur de la folie dès leur création. L’aliéniste français Morel disait que la psychiatrie était « le paratonnerre de la société», qu’elle devait attirer et contenir la folie pour protéger la société. Toutefois, cette logique projetait une image très négative de la psychiatrie et alimentait des préjugés négatifs à l’égard des malades mentaux.
Le terme « santé mentale» a alors commencé à être utilisé comme un euphémisme pour désigner la psychiatrie, en particulier lorsqu’il s’agit de développer les traitements et les soins psychiatriques et de justifier les dépenses qu’ils impliquent. Aujourd’hui, les discours publics sur la psychiatrie évitent de se référer directement à la psychiatrie, préférant parler de santé mentale, dans un mélange de prudence et de délicatesse frôlant parfois la pusillanimité.
4. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le seuil de sensibilité à la souffrance psychique s’est abaissé, comme l’avait fait auparavant le seuil de sensibilité à la douleur physique.
Cette évolution lente mais progressive se fait à des rythmes qui varient selon le contexte historique, géographique et social. L’une des conséquences de ce processus est l’augmentation des plaintes et des demandes de traitement.
Les « problèmes de santé mentale » sont aujourd’hui considérés comme de plus en plus fréquents.
Cette tendance s’inscrit dans un processus général d’élargissement du concept de santé. Ce qui est délicat, c’est que le domaine de la santé mentale s’étend de plus en plus au-delà des maladies mentales reconnues avec des traitements codifiés.
Si les DSM-III, IV et V décrivent de plus en plus de troubles, les pratiques deviennent moins encadrées lorsqu’elles s’éloignent des maladies bien identifiées pour lesquelles des consensus sont régulièrement recherchés. Aujourd’hui, il n’y a plus de frontières claires entre la maladie mentale, la souffrance mentale et les troubles légers de la santé mentale. Les termes de souffrance psychique et de troubles psychiques n’apportent pas de clarifications.
L’augmentation de la prescription de médicaments psychotropes aux adultes et maintenant aussi aux enfants est-elle toujours fondée sur une meilleure reconnaissance des troubles mentaux ?
J’ajoute, en tant que psychiatre et à titre personnel, que je ne considère pas que les traitements des troubles qualifiés de légers ou modérés soient nécessairement plus faciles que ceux des troubles sévères et puissent être délégués sans précaution. Le risque iatrogène, notamment d’induire une dépendance, est important.
5. Malheureusement, en réponse à ces nouvelles demandes, dont certaines relèvent de souffrances existentielles, une offre privée d'aide, de soins, etc. prometteuse mais non professionnalisée et non réglementée se développe.
Qualifier cette offre de « soins de santé mentale» est un dangereux détournement de terme.
Le risque de laisser se développer le mercantilisme et la psychiatrie au rabais est important.
-
Un article de Bernard Odier