MELANCOLIE, SUICIDE ET PERTE D’OBJET
25 novembre 2024MELANCOLIE
2 mars 2025FRANCHIR LA PASSE D'ABORD
Nous avons publié en mai 2024 un article consacré à l’angoisse de sexuation pubertaire . Cet article avant tout clinique fut étudié en référence à la psychanalyse par Jacqueline Schaeffer : « Pourquoi les filles ? » Nous proposons au lecteur une autre approche psychanalytique par Jean-Charles Bettan.
Approche psychanalytique de l'ASP par Jean-Claude BETTAN
Lorsqu’un sujet prend la décision d’entrer en analyse, c’est parce qu’il ne va pas bien. Et s’il est une consigne fondamentale à partager avec lui, c’est bien celle-ci : tant que le sol est meuble et traître sous ses pieds, il ne serait pas pertinent de prendre des décisions radicales, qui pourraient s’avérer ensuite regrettables. Mieux vaut attendre que le sol devienne plus ferme, que le pas soit plus assuré, la posture plus stable, afin que des décisions d’importance soient prises en toute clarté, en toute conscience, y compris dans toute l’étendue de leurs conséquences et dans la pleine acceptation de la responsabilité que cela implique.
Il en va de même pour la passe de l’adolescence, au sein de laquelle se bousculent de multiples influences. La révolution n’est en effet pas seulement intérieure : physique, physiologique, psychique, sexuelle. Elle est aussi extérieure, dans le sens où le sujet est soumis aux influences de la famille, de l’école, de la société, des camarades de classe, des réseaux sociaux… Sans oublier celles des activistes, des influenceurs, et de certains réseaux professionnels faisant preuve d’une complaisance coupable.
À l’Observatoire La Petite Sirène, nous faisons donc le constat qu’à l’instar du navire pris dans les remous d'une passe dangereuse, et seulement dans l’intérêt de l’enfant et de l’adolescent, il serait désastreux de répondre favorablement à des demandes pulsionnelles, d’acquiescer rapidement à des demandes fantasmatiques, de plier devant des revendications de l’instant. Bref, il serait pertinent d’attendre la sortie de la passe pour que le sujet soit en capacité de prendre des décisions en toute connaissance et en toute responsabilité des conséquences de ses choix. C’est notre ancrage.
Fondé par Caroline Eliacheff et Céline Masson, l’Observatoire La Petite Sirène est un collectif pluridisciplinaire de professionnels, praticiens et chercheurs, qui se penche sur les discours idéologiques concernant l’enfant et l’adolescent. L’Observatoire remplit également une fonction d’information à l’intention de tous les publics concernés par le sujet : les parents, les enfants et adolescents, les éducateurs, les enseignants, les pouvoirs publics, les professionnels de la santé et de la relation d’aide.
L’observatoire collationne des données, alerte sur les fake news et les discours fallacieux, apporte son soutien aux familles désemparées.
Ce collectif s’est formé à la suite d’un constat que nous avons été nombreux à faire, à savoir l’augmentation massive de diagnostics de « dysphories de genre » et de transidentité chez des sujets mineurs. Que le phénomène se produise, cela n’aurait rien de dramatique s’il était en première intention pensé. Ça n’a pas été le cas, et le problème est très rapidement venu de la réponse apportée à ce phénomène, une réponse immédiate et systématique, excluant toute concertation sociale, médicale ou psychologique, et entraînant des prises en charge médicales parfois très lourdes.
Ce que nous observons, ce sur quoi nous nous interrogeons, c’est sur l’emprise exercée sur ces sujets mineurs, sur leur immaturité psychique et donc leur vulnérabilité, sur leur revendication d’auto-détermination.
Ceci étant précisé, nous ne nions pas que, dans certains cas cliniques, la souffrance est fondée et qu’elle doit faire l’objet d’examens approfondis par les hommes de l’art. Il y a une vingtaine d’années, des enfants et des adolescents en souffrance dans leur questionnement sur leur genre étaient déjà reçus en consultation, mais ces situations étaient exemptes d’influences, ou en tout cas n’avaient rien de comparable avec la puissance délétère des influences multiples auxquels sont soumis aujourd’hui enfants et adolescents.
L’obstacle majeur auquel nous sommes confrontés est l’absence d’interlocuteurs en capacité d’entendre, et surtout de débattre… (j’ajoute « intelligemment »). L’on pourra trouver mon propos abrupt, je l’assume. En effet, les réponses que nous recevons la plupart du temps ne sont pas des arguments en retour des nôtres mais des catégorisations, des stigmatisations, des accusations. Nous sommes systématiquement taxés de transphobes, fachos, réactionnaires, totalitaires, et (tare ultime !) d’extrême- droite… Et j’épargne au lecteur quelques noms d’oiseaux.
Ces accusations, cette absence de débat, ce « je-veux-tout, tout de suite, à tout prix », ce « j’ai-bien-le-droit » évoquent des fixations infantiles. Je prendrai pour seul exemple la mésaventure vécue par Caroline Eliacheff et Céline Masson alors qu’elles étaient invitées à parler de leur livre La fabrique de l’enfant transgenre. C’était au café laïque de Bruxelles. Des activistes cagoulés ont fait irruption dans la salle, ont renversé les chaises, et ont jeté sur les participants… des excréments ! Mes collègues psychanalystes partageront probablement l’idée que, lorsque l’on parle de la passe difficile de l’adolescence en évoquant « le sexuel » et que pour toute réponse, on reçoit des excréments, la chose évoque un stade prégénital dans lequel semblent être demeurés coincés pas mal d’activistes.
Une dernière partie à mon intervention pour vous parler de clinique. Et je n’évoquerai que ma pratique personnelle. Vous reconnaîtrez qu’il y a plus stimulant que de recevoir un adolescent venant en traînant les pieds parce qu’il est poussé par ses parents. Adolescent la plupart du temps mutique, ou en colère, dans l’opposition systématique, qui n’a rien à nous dire, qui n’a pas envie d’être là, qui n’a pas besoin d’un psy, qui sait mieux que personne ce qu’il ressent, etc. Donc, comme pour de nombreux collègues, se pose la question d’une éventuelle stratégie. Evidemment, cela n’a rien d’orthodoxe de parler de stratégie en psychanalyse. Mais bon ! Pour plagier Winnicott : « Je suis psychanalyste et je fais de la psychanalyse. Et quand je ne peux pas faire de psychanalyse, eh bien je fais autre chose ». Parce que, voyez-vous, sans transfert, que faire ? Ou, soyons plus modeste, sans communication acceptée par l’autre, que faire ?
Eh bien, il faut l’instaurer, cette communication. Comment ? La solution qui consiste à faire copain-copain ne fonctionne pas. La posture du psy « moi je sais, je vais t’expliquer » est un échec assuré. Les phrases intrusives du genre « et comment ça se passe au lit avec ton copain (ou ta copine) ? » méritent qu’on retourne deux baffes à ceux qui osent les prononcer. Que reste-t-il ? L’écoute, évidemment, si parole il y a de la part de l’autre. Quelques reformulations, qui feront mouche ou pas : « Je comprends que vous n’ayez absolument pas envie ni choisi d’être ici. Je comprends que vous soyez en colère. Je sais que vous n’attendez qu’une chose, c’est de repartir ». Et puis ?…
Et puis, la grande question : qu’attendons-nous de cette rencontre ? Personnellement, je n’envisage même pas l’issue de notre travail. Je veux dire par là que je ne la souhaite ni comme ceci ni comme cela. Je ne suis pas là pour détordre quelque chose qui serait tordu. Ma seule préoccupation est d’accompagner l’adolescent suffisamment longtemps pour qu’il prenne le temps de s’interroger, et que cette interrogation produise ses fruits, quels qu’ils soient. Pour que la décision qui sera prise par l’intéressé soit auparavant passée et repassée au crible de sa réflexion critique. Qu’elle ait été suffisamment éclairée par une histoire, un contexte, et la reconnaissance de l’existence d’influences diverses. Pour résumer, je dirais que mon but est d’inviter à penser, à prendre conscience d’un certain degré de soumission, et à donner envie de s’affranchir des influences qui exercent cette soumission. Autrement dit, à penser plus librement qu’auparavant. Et encore une fois, quelle que soit la décision finale.
Est-ce que je fais quelque chose pour y parvenir (lorsque j’y parviens !) ? Eh bien, je joue sur la surprise, l’étonnement, la curiosité, la réorientation de la pensée, la tentative de susciter un intérêt qui décentre l’adolescent de sa demande obsédante. D’abord, je ne tutoie pas l’adolescent. Je ne suis ni un pote ni une instance supérieure. Ensuite, mon cabinet, c’est un peu un cabinet de curiosités. L’Afrique est très présente, des objets étranges ou inhabituels attirent l’attention, on y trouve des références au théâtre, au cinéma, à la bande dessinée. Il est assez facile d’orienter la conversation vers un sujet qui n’a rien à voir avec la raison pour laquelle les parents ont poussé l’adolescent à venir. Bref, quitte à ce que la première rencontre soit « simplement » une accroche, je n’en demande pas davantage. Mieux vaut un accord pour une seconde rencontre qu’une rencontre inutile. Donc, capter l’attention, susciter l’intérêt, la curiosité, donner envie de revenir.
Et puis, me direz-vous ?
Et puis, j’ai recours au théâtre. Je transforme mon cabinet en scène de théâtre. En actor’s studio. J’invite l’adolescent à expérimenter des rôles dans lesquels interviennent le sexe (masculin ou féminin), l’âge, la condition sociale, tout le spectre des sentiments et émotions, et des situations classiques ou surprenantes. Il m’arrive même assez souvent de participer, lorsque je propose de travailler un dialogue au lieu d’un monologue. Je bouscule l’adolescent : « Vos pieds ! Ouvrez la poitrine ! Respirez plus fort ! C’est pas de la colère, ça, dites-le plus fort ! Quoi, c’est une déclaration d’amour, ça ? Mais ça donne plutôt envie de fuir, allez on recommence ! »
Alors, à ce moment de mes explications, je vais devancer la question qui m’est toujours posée : comment faites-vous pour que l’adolescent, venu poussé par ses parents, accepte de se prêter à cet exercice de théâtre ?
Eh bien, dans le meilleur des cas, c’est la conséquence de l’acceptation par l’adolescent d’un constat que nous faisons tous deux : l’existence d’un profond manque de confiance, la présence d’un brouillard de questions dans la tête, un état d’angoisse patent.
Quelle réponse plus active (quand elle est acceptée) que de faire travailler la voix, le ressenti, le fait d’habiter la peau d’un autre ou d’une autre, le corps tout entier dans sa cohérence avec les mots prononcés ? L’expérimentation ne fait pas seulement sortir l’adolescent de son idée fixe ; elle ne fait pas que le décentrer de la demande initiale. Elle crée du mouvement, elle crée du neuf, elle fait bouger les bases. Elle ouvre. Et je dirai qu’elle désintoxique, ou en tout cas qu’elle contribue à désintoxiquer la psyché de l’emprise des autres sources d’alimentation de l’adolescent. Finalement, le travail que nous effectuons est le même que celui qui a pour objectif de libérer un sujet d’une emprise sectaire.
Je trouve encore un autre intérêt à ce travail. Puisqu’il est question de théâtre, puisqu’il est question de jouer à être un autre, l’occasion est belle de glisser un parallèle entre la scène du théâtre et les coulisses, derrière le rideau. En effet, si l’on compare ce qui est visible au symptôme du moment, et ce qui est invisible, derrière le rideau, à ce qui a généré le symptôme, il est d’un intérêt majeur que l’adolescent trouve à s’interroger, non plus seulement sur sa demande, mais sur les influences qui l’ont générée, cette demande. Cela s’appelle tout bonnement penser. Et aujourd’hui, penser se trouve réduit, empêché, laminé par les forces carcérales des influences plaçant l’adolescent sous emprise.
C’est grâce à ce parcours qu’un moment arrive où la pâte que nous travaillons à deux n’est plus une revendication liée au genre ; elle devient un travail sur ce que nous appelons l’angoisse de sexuation pubertaire. C’est seulement à partir de ce moment-là que cette matière à pétrir nous devient enfin accessible à tous deux. C’est à ce moment-là que cette pâte faite de détresse, d’angoisse, de questionnements multiples, nous est enfin proposée. J’ai envie de dire que c’est à ce moment-là que le vrai travail commence. Mais un travail qui ne peut être réalisé si les phases précédentes ne se sont pas déroulées avec succès. Autrement dit, un travail qui ne peut avoir lieu sans communication acceptée par l’autre. Sans transfert.
Jean-Charles BETTAN
Nous remercions Jean-Charles Bettan de nous avoir proposé de publier son intervention en tant que représentant de l’association L’Observatoire la petite sirène au colloque l’Association Lacanienne Internationale (Section Rhône-Alpes)
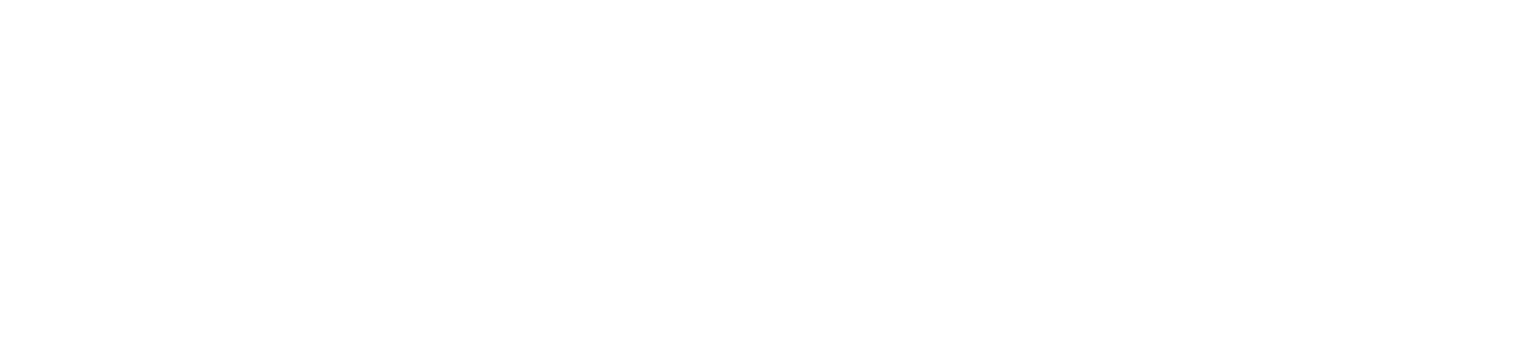
1 Comment
merci jean charles de cet éclairage encore une fois
nous apprenons de nos patients que chaque histoire est particulière
et le sera toujours pour nous et pour eux