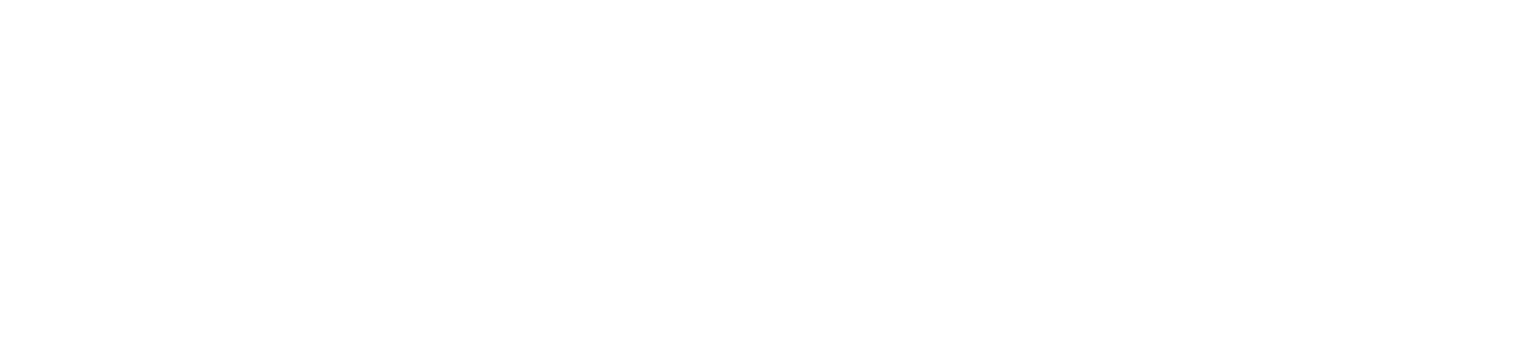D’ABORD, FRANCHIR LA PASSE
3 janvier 2025La « médecine de genre » pour mineurs ou le sermon d’Hippocrate
5 mars 2025MELANCOLIE
Notes introductives à la lecture de l'article de Jackie Pigeaud, par le dr. Alain Ksensee
L’article de Gladys Swain auquel se réfère Jackie Pigeaud au début de sa réflexion est un article d’une importance fondamentale : Permanence et transformation de la mélancolie qui fut publié la première fois dans la revue médicale de la Suisse romande de 1989 est d’une importance considérable. Il fut d’ailleurs repris dans son livre avec Marcel Gauchet : Dialogue avec l’insensé et publié par Gallimard en 1994. Il devrait être médité par chaque psychiatre. Swain y analyse comment la mélancolie, à travers les classifications, révèle la tension constante entre la nécessité de définir la maladie mentale et la reconnaissance de son ancrage dans l'expérience humaine. Elle met en lumière la difficulté de séparer radicalement le pathologique du commun.
C’est en fait le début de l’article de notre auteur qui la cite excellement. En effet Gladys Swain, soulignons le une nouvelle fois, montre à qui veut bien la lire et faire quelques discrets efforts comment la mélancolie par le simple jeu des classifications met en lumière comment les psychiatres ont été obligés en quelque sorte en revenant après la tentative d’Esquirol d’en faire une maladie autonome, de reprendre le terme vulgaire de mélancolie qui conduit au « besoin socialement défini de conserver une charnière entre l’état qui relève de la psychiatrie et l’ordinaire de la réalité humaine. » Cette tension trouve un écho particulier dans le DSM-5, qui tente de redéfinir la mélancolie comme un "spécificateur" de l'épisode dépressif majeur, la rapprochant ainsi d'une entité clinique distincte. Cette approche, qui vise à isoler la mélancolie du spectre plus large de l'expérience humaine ; ne rappelle-t-elle pas la tentative d'Esquirol au début du XIXe siècle, comme le précise Gladys Swain ? Il avait cherché à établir une maladie autonome, la lypémanie, qui, malgré ses espoirs, fut finalement abandonnée au profit du terme plus commun de "mélancolie".
Et, continuant son propos, Jackie Pigeaud évoque Freud qui dans son article Deuil et mélancolie se demande comment et pourquoi un sujet devient un malade mental en discernant la condition humaine et son lot de destructivité, de malhonnêteté… Cette réalité humaine et son lot d’infamies « que nous dit » le mélancolique ne permet pas au psychiatre de retrancher le « malade » du monde commun. Freud va montrer, expliquer les racines pulsionnelles de ces vérités, l’importance de l’investissement narcissique de l’objet préciser entre autre, « en réalité, » de « qui » il s’agit… Tragédie individuelle qui est en continuité avec celle de la condition humaine ?
Pigeaud, à son tour, propose une lecture qui invite à dépasser les classifications rigides, en explorant les liens profonds entre tragédie individuelle, maladie mentale et condition humaine. »
L'article Mélancolie
Je vais reprendre ici des propos que l’on pourrait croire obstinés ou ressassés. Ce n’est, je pense, que conviction et méthode.
Il s’agit, de réfléchir sur l’unité de la mélancolie. C’est le thème que nous avons proposé. En fait, il ne s’agit ni d’un thème, ni d’une thèse, mais plutôt d’un problème fondamental et actuel, d’une question consubstantielle à la mélancolie.
La mélancolie nous intéresse. Elle nous intéresse tous, et à tous les sens du terme. D’abord parce qu’on se reconnaît, d’une certaine façon, dans la mélancolie. Nous n’avons jamais rompu avec la mélancolie. Les tentatives diverses pour l’éliminer ou la réduire à une autre maladie (celle par exemple d’Esquirol), ont échoué. Sur la mélancolie, il semble que chacun ait quelque chose à dire. Dans ce vague sens qu’on lui donne souvent, la mélancolie se confond en effet avec la tristesse, la teinte un peu sombre que chacun peut donner au jour suivant son humeur ; mais son humeur justement, c’est déjà un mot compliqué. Je veux dire par là, comme le suggère l’auteur post-aristotélicien du Problème XXX, que suivant son propre vécu, au sens le plus organique du terme, chacun sait bien que la vie peut ne pas être légère et que le malaise, indéfini souvent, peut naître. Mélancolie... Gladys Swain, dans un article d’une remarquable élégance et hauteur de vue, reprenait cette question du nom : « Pourquoi cette insistance sur une minuscule aventure terminologique qu’on pourrait, somme toute, juger de médiocre portée ? Parce que à sa mince manière, elle signale un phénomène d’importance : l’impossibilité pour la psychiatrie d’accomplir son retranchement d’avec le monde commun.
Invinciblement, en dépit de toute l’ambition scientiste qui peut ordinairement les animer, les psychiatres se sentent comme obligés, en ce lieu de la mélancolie, de maintenir ou de rétablir le contact avec le langage ordinaire. Comme s’il fallait dans le système des notions psychiatriques au moins un terme par lequel garder une ouverture sur la conceptualité quotidienne (1). »
« Il doit y avoir un mot », écrit Gladys Swain, « où s’indique une continuité entre une pente banale de l’âme et son exaspération folle. Il y a au moins une folie qui communique immédiatement avec les affections et les humeurs de tous les jours, une folie à laquelle on passe insensiblement et dont on sort de même sans rupture certaine. Voilà, semble-t-il, ce qui symbolise l’équivoque sémantique du terme mélancolie » (2).
C’était déjà, nous l’avons vu, la théorie du Problème XXX du Pseudo Aristote.
Il y a plus. « Mélancolie = folie en laquelle se reconnaître : voilà ce qui est resté du continent de culture perdu avec l’âge classique. Duplicité de la mélancolie ; il faut y reconnaître à la fois une folie, au sens précis, médical, du terme, et une expression de l’âme humaine en sa nature profonde », écrit encore Gladys Swain (3). On échoue à vouloir changer le terme, en apparence trop flou, trop large en extension ; on échoue à vouloir le supprimer et à distribuer en symptômes ce qui lui appartient quand même. La mélancolie, c’est ce qui nous fait communiquer immédiatement avec un fait biologique en même temps qu’avec la tradition la plus ancienne de notre culture. Mais cette immédiateté fait évidemment tout le problème.
Unité de la mélancolie. Nous savons, c’est une banalité qu’il faut répéter, que si l’homme est statutairement, ontologiquement, identique dans le temps et dans l’espace, la prise de connaissance qu’il a de lui-même et qui le constitue comme être historique se fait dans le temps. Or aucune autre maladie, comme la mélancolie, ne fait s’affronter comme cela, dans sa constitution, l’être et le temps, l’essence et la durée historique, et même la nature et l’anecdote. Comme le dit si bien le pythagoricien Archytas de Tarente : « De la même façon qu’il est difficile de trouver un poisson sans épine (arête), ainsi l’est-il de rencontrer un homme qui n’ait pas en lui quelque chose de douloureux comme une épine (4). » Archytas joue là sur le double sens de l’achante, l’épine, l’arête. L’épine est une expression de la douleur mélancolique déjà dans le Corpus hippocratique. Mais, pour le poisson (et pour l’homme, comme semble le suggérer Archytas), c’est aussi ce qui le constitue, qui le fait se maintenir et lui donne forme.
On est, à propos de la mélancolie, comme empêtré de culture. Il est difficile de procéder à un déshabillage ; l’objet mélancolie est fait d’implications, et non de substrats qu’on pourrait dégager avec méthode. Le livre de Klibansky, Saxl, Panofsky Saturne et la mélancolie, dont on ne dira jamais assez le caractère pionnier et l’indispensable érudition, s’épuise et s’enterre finalement dans les strates. La méthode cumulative, pour ce qui est de la mélancolie, conduit nécessairement à l’ensablement et à l’aporie.
C’est qu’il faut penser l’unité, en effet, du point de vue synchronique et diachronique en même temps. Il faut essayer de saisir ce problème pour tenter de sortir du rabâchage historique, et proposer en même temps aux spécialistes de la psychopathologie, une problématique où ils se retrouvent nécessairement dans l’histoire.
Quel rapport existe-t-il entre tel malade prostré, torpide et sans paroles, entre ce malade muré et clos sur lui-même, et le créateur brillant et jaillissant, dans quelque domaine que ce soit, du Problème XXX par exemple ? « Car tous les deux sont dits mélancoliques. » C’est une question à première vue en effet d’une très grande naïveté. Elle accepte, en effet, d’un seul coup, toute la tradition, tout le déferlement de la littérature sur la mélancolie ; et elle se formule en même temps en des termes résolument actuels. Cela signifie que l’on doit accepter d’affronter la question de la maladie et celle de toutes les variations que l’imagination a tissées autour d’elles.
Cela veut dire aussi qu’il y a une réalité, un noyau de nature, dans la prolifération des textes ; et que la maladie, le fait pathologique, comporte en même temps quelque chose de culturel qu’il faut essayer d’évaluer. Jamais nous ne devrons perdre de vue que la mélancolie nous oblige à tenir ensemble, de manière qui fait problème, la tradition et l’actualité, l’imaginaire et le fait biologique, nature et culture. Comme nous essayons, Yves Hersant et moi, de le montrer dans un livre à venir, il faut prendre le pari d’accepter à la fois le déluge des textes et l’hôpital, si l’on veut pardonner cette formule rapide.
Aucune autre maladie ne se propose, dans sa constitution comme fait de culture et ne renvoie, de cette façon obstinée, la culture a quelque chose de sourd et d’aveugle, qui est à la fois de l’ordre de la nature, de l’individu, de l’incommunicable, du pathologique. C’est pourquoi, je le répète, il faut tenir ensemble, de manière paratactique : comme l’Aphorisme VI, 23 d’Hippocrate le faisait déjà, le donné naturel et le comportement, ce qui deviendra le viscère et l’âme. Il faut réunir, comme le Problème XXX le suggère, le tempérament et la créativité ; et, comme les Lettres du Pseudo-Hippocrate et la tradition du Pseudo-Démocrite nous y incitent, la maladie et l’histoire. C’est ce que savait déjà l’admirable Burton. « ’Tis all one », écrivait-il. La mélancolie ne peut se dévoiler que dans le temps, dans l’histoire ; mais en même temps l’histoire ne fait que déployer dans le temps ce qui est le drame intime, unique, de chaque malade.
Nécessité d’une idée conditionnelle
Pour avancer, ou plutôt pour essayer d’organiser, il nous faut ce qu’on peut appeler une idée ou une hypothèse conditionnelle, au sens où Rousseau la définissait (Préface du Discours sur l’inégalité) :
« Ce n’est pas une légère entreprise de démêler ce qu’il y a d’originaire et d’artificiel dans la nature actuelle de l’homme, de bien connaître un état qui n’existe plus, qui n’a peut-être point existé, qui probablement n’existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d’avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. » Et, plus loin : « Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclaircir la nature des choses qu’à en montrer la véritable origine, et semblables à ceux que font tous les jours les physiciens sur la formation du monde. »
Notre hypothèse conditionnelle tient à l’unité de la mélancolie, dans toutes ses manifestations. Il faut essayer de montrer que ce que l’histoire a déployé dans les siècles – cette expansion vers la maladie d’une part, et vers l’imagination créatrice de l’autre – est le développement d’une structure constitutive de la mélancolie.
Il faut donc prendre acte de ce caractère obstiné de la mélancolie et de sa permanence. Ou alors, si on le pense, montrer que c’est un fossile, un résidu archéologique. Il faut que les historiens et les praticiens collaborent. Ni les uns ni les autres, s’ils se séparent, ne peuvent prétendre à cerner une vérité de la mélancolie. Par définition. On peut penser que c’est une illusion. Alors qu’on le montre ; que chacun parle du point de vue de sa pratique et de sa discipline. Mais que l’historien n’oublie pas qu’il s’agit aussi de maladie et de souffrance ; et que le psychiatre et le psychanalyste n’oublient pas qu’il s’agit aussi, et nécessairement, d’histoire.
Quand on s’attaque à la question de la mélancolie, on est toujours confronté à la difficulté de rendre compte de ce qui est du temps, de ce qui est du non-temps, ou du hors-temps ; de l’histoire et du droit, du vécu et du sens, non pas comme une synthèse mais comme le problème même de la synthèse que le fait mélancolique propose.
La mélancolie n’est pas une maladie comme les autres. Un mélancolique est un malade d’une certaine espèce, peut-être d’une maladie unique dans son essence, qui met ensemble, de manière problématique, une souffrance qu’il peut désigner et le soupçon que cette souffrance signifie plus qu’elle-même et donne à dire à la fois sur la connaissance de soi et sur le sens de l’être. C’est bien le lien entre la souffrance et le sens qui fait tout le problème de la mélancolie.
On connaît la thèse socratique qui veut que l’on ne saurait se connaître que médiatement, qu’il faut poser un autre hors de soi, fût-ce par le moyen du miroir, pour se percevoir, se reconnaître et se juger (5). En quelque sorte la mélancolie exprime par la souffrance l’impossibilité de poser cet autre ; elle est maladie qui concerne l’unité de l’être ; pour parler un langage démodé mais tellement commode, elle est maladie du rapport de l’âme et du corps. La mélancolie implique la nécessaire urgence de sortir de soi ; c’est-à-dire de briser l’unité, le continuum. On pourrait dire qu’elle est la pathologie du monisme. La mélancolie est maladie de l’unité de l’être. Il faut bien concevoir qu’il existe une différence entre cette prise de conscience de soi qui exige le miroir, l’identité, un analogon fixe et stable, un jugement de comparaison et l’affirmation d’une valeur ; et d’autre part une connaissance de soi par la détente, par l’arrachement sans rupture véritable, par le transport, qui garde toujours avec elle la nostalgie d’un continuum antérieur. On comprend que l’éthique ne soit pas le problème essentiel de celle-là, puisqu’elle ne s’attribue pas de point de vue d’où se juger, mais que son attitude morale, s’il lui arrive d’en avoir, ne peut être qu’une posture temporaire (6).
Elle montre la nécessité du dualisme, c’est-à-dire de déchirer cette unité qui fait souffrir. Elle pousse à sortir pour se poser en dehors de soi, établir un point de vue d’où s’observer, se juger. Cela ne se peut faire que dans la poussée, le jaillissement.
Considérons cette plainte du malade où se trouve enfouie la vérité de la mélancolie, et l’endroit de son corps où il souffre. Qu’est-ce que cette souffrance ? Cette ligne nécessaire où je souffre de ne pouvoir la recommencer et qui n’est plus qu’une ligne de douleur confuse... Il faut voir là qu’il y a un temps, où l’avenir n’existe pas encore ou n’existe plus comme possible. Entre cette souffrance d’avant et cette souffrance d’après, il n’y a plus de différence ; c’est un temps d’éternité, ou encore, si l’on veut, le temps naturel, le temps de la physiologie, le temps de la confusion biologique. Le mélancolique soit n’a pu exercer le nécessaire déchirement, soit a échoué pour retomber dans le continuum. Pour lui, il n’est plus de métaphore possible ; on peut dire aussi que pour lui la métaphore n’existe pas ou n’a pas de sens. C’est le monisme du malade, de l’être replié sur soi et souffrant de ce repli, ignorant la métaphore. Ce monisme pathologique n’a évidemment rien à voir avec un monisme philosophique cohérent, qui pose l’être comme un, et oblige à le penser comme tel.
Le drame de la mélancolie, c’est qu’on l’interroge pour savoir si sa souffrance est somatique ou psychogène. Ce langage n’a tout simplement pas de sens pour elle. C’est le « dualisme » qui a contraint à installer la mélancolie dans un espace qui n’est pas fait pour elle, où elle n’est pas née. La désignation du viscère, comme les patients de Blondel le lui montrent, n’est pas l’essentiel. C’est le génie de la bile noire de contenir assez de substantialité pour faire illusion sur la réalité de l’organique. La recherche d’un siège de la mélancolie est évidemment vouée à l’échec comme toute spatialisation qui tombe dans le piège dualiste. La même remarque vaut pour toute approche « psychologique ». La comparaison entre le deuil et la mélancolie montre qu’ils ne sont absolument pas recouvrables ni symétriques. Freud écrit : « Lorsque dans son autocritique exacerbée, il (le mélancolique) se décrit comme mesquin, égoïste, insincère... il pourrait bien, selon nous, s’être passablement approché de la connaissance de soi, et la seule question que nous nous posions, c’est de savoir pourquoi l’on doit commencer par tomber malade pour avoir accès à une telle vérité » (Deuil et mélancolie). Nous n’avons rien à changer à cette phrase, sauf cette chose essentielle : il faut donner à la connaissance de soi un sens logique et non psychologique. On comprend, en revanche, que cette pensée n’ait rien à voir avec la morale, comme le souligne Freud.
Au fond, c’est un lieu commun, au sens le plus rhétorique ; mais en même temps c’est le lieu qui nous est commun, tout au moins en Occident, lieu que nous habitons tous de façon plus ou moins fugitive ou constante ; lieu commun au malade et au médecin qui le soigne ; maladie de la culture certes, mais aussi possibilité d’intégrer le malade dans l’histoire de la culture.
Il ne s’agissait pas ici que chaque auteur choisît comme thème « l’unité de la mélancolie », mais qu’il eût, si possible, ce problème à l’horizon de sa réflexion, et que le lecteur, en tout cas, devant la diversité des articles, la prît au sérieux comme un problème actuel et constant de la mélancolie.
Par Jackie PIGEAUD
Notes de l’auteur
- Gladys Swain, Permanence et transformations de la mélancolie, in Dialogue avec l’Insensé, Paris, N.R.F., 1994, p. 168.
- Op. cit., p. 169.
- Op. cit., p. 172.
- In Aelien, Var. Hist.
- Cf. par exemple J Pigeaud, L’art et le vivant, Paris, Gallimard, 1995.
- Nous renvoyons à notre introduction de L’homme de génie et la mélancolie, Paris, Petite Biliothèque